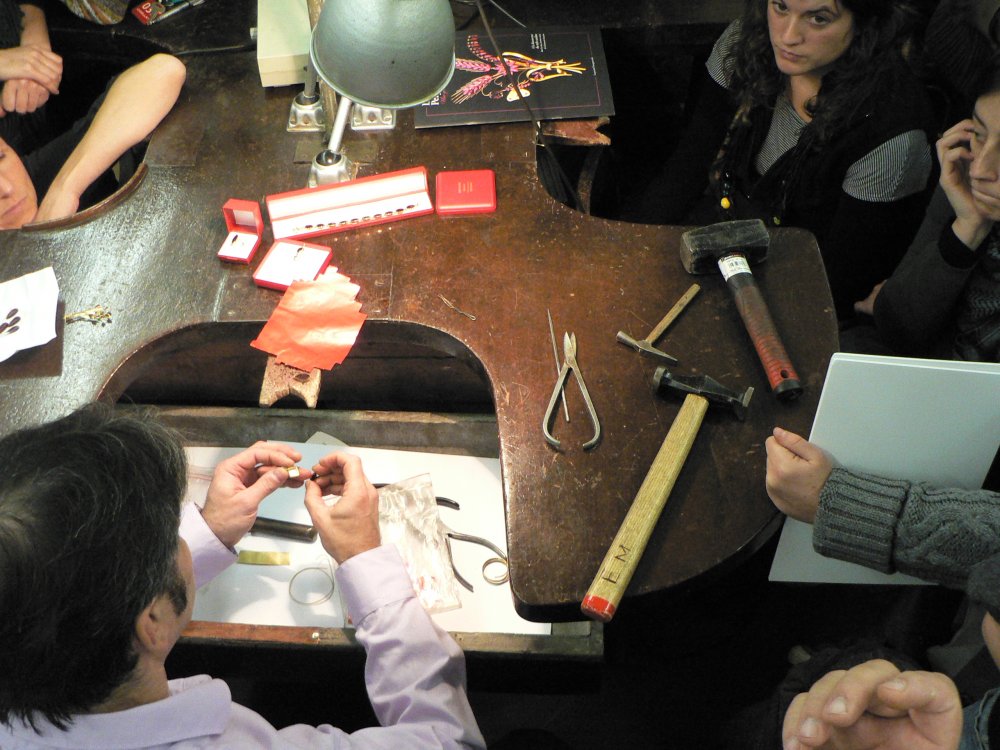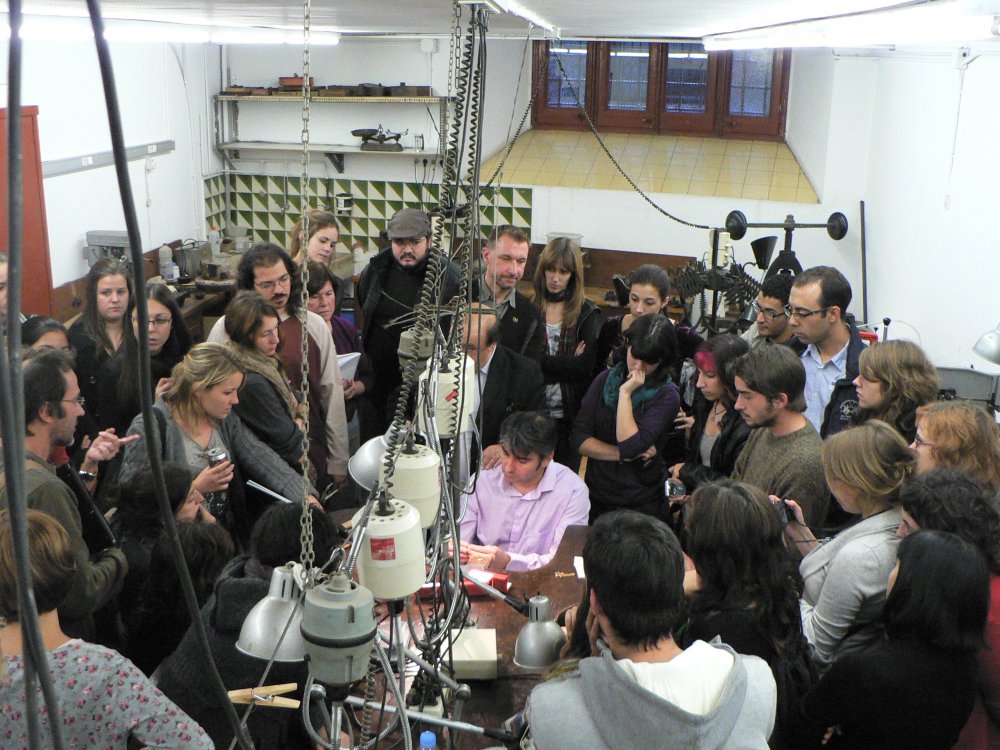https://www.youtube.com/watch?v=18SA2tKQddk
Les archives départementales des Pyrénées-Orientales conservent un fonds très riche, dont une très grande partie reste à redécouvrir. C’est dans les papiers de la famille D’AX de CESSALES que se trouve un cahier manuscrit anonyme. C’est probablement là l’écriture de Jean-François D’AX de CESSALES, qui fut lieutenant dans le Royal Infanterie dans les années 1760.
Contexte historique : Minorque devient une possession britannique dès 1708. Ciutadella va perdre alors son statut de capitale de l’île, au profit de Mahon, qui abrite la base navale. C’est au début de la guerre de Sept Ans que les français prennent Minorque en 1756. Toutefois l’île redevient britannique par Traité en 1763 en échange de Belle-Ile en Mer. Les forces franco-espagnoles s’empareront de l’île en février 1782. jusqu’en 1798 où elle est récupérée par les Britanniques.
L’auteur : Jean-François D’AX, baron de CESSALES a eu une longe carrière militaire. Il fit notamment la campagne du Canada en 1754 sous les ordres du marquis de MONTCALM, blessé et fait prisonnier en 1758 au siège de Fort-Ville-Marie en Nouvelle France. Il fut conduit prisonnier en Angleterre puis retourna en France fin 1758 après avoir été échangé. En 1759 il entre au régiment Royal Infanterie pour la campagne de Minorque jusqu’en 1763. En 1777 on le retrouve capitaine des canonniers garde-côtes du Roussillon. Il fut aussi présent à l’Assemblée de la noblesse du Roussillon de 1789. Son épouse était Marie-Thérèse de Cabestany.
Nous pouvons donc dater le manuscrit des années 1760. Nous avons notamment la mention de Philippe-Charles-Jean-Baptiste Tronson du Coudray, militaire français, né à Reims en 1738 et mort à Philadelphie en 1777, commandant du Royal Infanterie sur la place de Minorque.
Description de l’île de Minorque et de se habitants
L’île de Minorque, la moindre des Baléares, est située sur la mer Méditerranée, le long des côtes d’Espagne. Elle passe dans l’histoire pour avoir été le théâtre de la guerre ente les Carthaginois et les Romains, qui y ont dominé tour à tour, les Maures en ayant fait la conquête, les naturels du pays, Espagnols d’origine. Le roi Alphonse le catholique les en chassa après plusieurs combats qu’il dona sur les différents points de l’île et elle resta au pouvoir de ses descendants […].
[…] un grand nombre, ceux qui errent dans les champs toute l’année, c’est la monture ordinaire du pays, et vont toujours au petit galop. On leur fait porter jusqu’à trois quintaux, quoiqu’ils soient d’une taille ordinaire, et les mulets portent jusques à cinq. L’hiver est très supportable dans cette île et l’été la chaleur est si forte, depuis cinq heures du matin jusqu’à six du soir, que l’air commence à se lever, qu’on ne sait où se mettre, et on a le désagrément de ne pas pouvoir boire à la glace, n’y en ayant point dans ce pays-ci.
L’île de Minorque est séparée de celle de Majorque par un canal ou bras de mer d’environ sept à huit lieues. Celle-là dépend de celle-ci pour le spirituel, n’y ayant qu’un seul évêque pour les deux îles, qui fait sa résidence à Palma, et qui a un grand vicaire à Mahon.
Mahon est à l’est de l’île de Minorque. C’est une assez grande ville, non murée, bien peuplée. Le gouverneur y fait sa résidence. Elle est célèbre par son fondateur Mago, général carthaginois qui lui donna son nom. Elle est remarquable par la sureté de son port, qui est en forme de rivière dans son entrée, et ressemble à un grand bassin dans son enfoncement. Toutes sortes de gros vaisseaux peuvent y mouiller dans toutes les saisons et y sont à l’abri de toute sorte de vents. L’entrée de ce port est défendue par le fort Saint-Philippe qui est un carré ancien, auquel les Anglais ont ajouté des ouvrages de toute espèce. Cette place peut contenir dix à douze mille hommes. Elle est bâtie sur le roc, et est presque imprenable, tant à cause des ouvrages extérieurs qu’à cause de l’impossibilité qu’il y a d’y ouvrir des tranchées, le terrain qui l’environne étant un roc très vif. Cette place a coûté plus de cent millions aux Anglais et presque quarante ans de travail. Cette forteresse remplit l’idée qu’on peut se former d’une place à laquelle l’art joint à la nature n’a rien oublié pour la rendre imprenable, étant munie des provisions de guerre et de bouche et d’un bon commandant.
Partant de ce fort pour aller à Mahon, qui est à demi-lieue, on trouve la Raval, qui est un village d’une grande étendue et très peuplé. C’est à Mahon qu’est le siège du tribunal de justice. On trouve sur le grand chemin qui mène de cette ville à Ciutadella, que les anglais ont fait construire depuis quelques années sur le terrain le plus élevé de la ville, on trouve dis-je à deux lieues de la ville de Mahon à peu de distance de ce même grand chemin, et à deux lieues de celle-ci, le village de Mercadal, qui est moins considérable, et à cinq quart de lieues de ce village, est Fornelle, petit hameau habité par des paysans. Il y a un château et un assez beau port. Monsieur du Coudray, capitaine dans le Royal, en est commandant.
Sur le midi de ce fort et à demi-lieue l’on voit la plus haute montagne qu’il y ait dans l’île, appelée Mountor, sur le sommet de laquelle est bâti un monastère habité par quarante Augustins qui conservent dans leur église la statue de la Sainte Vierge, à laquelle les insulaires ont une très grande dévotion, et où ils vont faire des neuvaines en tout temps. On y a bâti une auberge pour les vieillards. Les moines pleins d’attention ne leur offrent point leur chambre dans le monastère de crainte de les gêner, mais aussi en revanche, leur charité est si grande qu’ils cèdent la moitié de leur chambre à toute autre personne de quelque sexe que ce soit, leur cherchant toute sorte d’amusements pour les désennuyer, mettant même les danses en usage, étant assurés que dans ce pays-ci on les aime beaucoup. Pour ce qui est de la table, les hommes qui vont dans ce monastère se pourvoient des vivres et du vin en abondance qu’ils mangent et boivent avec les moines. Les femmes, ne pouvant se charger de faire tous ces préparatifs, servant hardiment au monastère où elles sont assurées d’être reçues à bras ouverts par les moines qui sont bien aise de trouver cette occasion pour exercer leur grande charité, charité qu’ils font de si grand cœur, qu’ils sont à la porte pour les attendre. Et comme ils ont coutume de manger dans leur chambre avec les estrangers, ils se disputent lorsqu’ils en voient venir quelqu’une qui l’aura, chacun la tirant de son côté, faisant en sorte de la faire céder par son camarade, par des bonnes raisons comme le plus jeune, disant que le R.P. Prieur dira, ne lui voyant pas exercer de charité, que c’est un malheureux qui ne pense qu’à ramasser dans ce monde, et finira par l’envoyer en pénitence. Le plus ancien répond qu’il doit la lui céder comme étant un supérieur, et qu’en vertu de ladite obédience, il lui ordonne d’attendre qu’il en vienne une autre, mais celui-là, digne augustin du Montor, la veut absolument, et [ils] finissent ordinairement par se la disputer à coups de poings, si bien que la proie reste au plus fort. Aussi voit-on peu de vieillards exercer leur charité envers les femmes. Ils se contentent de tenir compagnie aux hommes, à table, pour les empêcher de s’ennuyer.

Le village de Ferraries est à un quart de lieue du grand chemin, tout près de Ciutadella. Cette ville-ci passe pour être la capitale de l’île. Elle est à sept lieues de Mahon, elle a un assez beau port, est entourée d’un mur, fort belle, bien peuplée, et c’est dans cette ville que la noblesse du pays fait sa résidence. Il y a des maisons religieuses, de belles promenades et une source très abondante, ce qui est une rareté dans l’île où l’on ne boit que l’eau de citerne, les petites sources étant près de la mer et trop éloignées de la ville pour que l’on puisse y aller puiser. On n’y a pas bâti tout près afin de se mette à couvert des descentes que pourraient faire les Maures.
On voit près de Cuitadella une grotte spacieuse que la mer a formée, grande d’environ un mille et tous les ans les gens de Cuitadella y vont en bateau, avec des torches à la pêche des loups marins qui vont s’y mettre à l’abri, et l’on prend aussi d’autres poissons. On pèche sur les côtes de Ciutadella comme sur ces cotes-ci toute sorte de coquillages. Il y en a de très curieux par leurs formes et par l’émail qui est de différentes couleurs. L’on en fait toute sortes d’ouvrages comme des surtouts pour les tables, des paniers, des oiseaux et tout ce que l’on peut s’imaginer, mais comme il y a beaucoup d’ouvrage c’est très cher.
Le langage du pays est un mélange d’espagnol, de catalan, de provençal, d’italien et d’arabe.

Explication de la manière de vivre des habitants, de leur habillement et de la façon d’agir entre eux.
Ce peuple est fort sobre. Il ne vit que d’oignons, de courges, de laitues, de tomates, des choux, des raves, des poivrons même les plus rouges, le tout cru et sans être garni, comme venant du jardin, toujours sans pain, et lorsqu’une personne du pays trouve une feuille de chou ou cotte de melon, ou bien autre chose semblable dans les rues, elles ramassent cela et le mangent tout de suite. Il est très rare de leur voir manger de la viande mais lorsqu’ils en mangent ce n’est que de la chèvre et du pain sans levain que l’on pétrit avec de l’eau froide, n’y ayant que le seul grain de blé, car pour si cher qu’il soit, ils le trient sur la table, venant de l’acheter. Pour manger tout cela, ils se mettent à table et font mettre leurs domestiques avec eux.
Ils sont superstitieux à l’excès, très attachés à leurs anciens usages. Le fils faisant par habitude et avec une espèce de relation ce qu’à fait son père quoique le blâmant peut-être dans son intérieur.
Les femmes y sont assez belles, peu façonnées et très impolies. Elles sont habillées comme le sont nos religieuses en France, ou à peu près, portant une petite veste qu’elles lassent par devant ayant des manches fort étroites, ouvertes presque depuis le coude, jusqu’au poignet, qu’elles ferment avec des boutons d’or ou d’argent, ou bien de jais. Elles ne devraient porter autre chose que cette veste, attendu que de cette façon elles laisseraient voir une taille très belle qu’elles ont ordinairement mais elles mettent sur leur tête une espèce de mante blanche ou noire qui leur tombe jusqu’aux genoux, et qu’elles quittent si tôt qu’elles rentrent chez elles. Et dans leur maison elles portent tant en hiver qu’en été une petite coiffe ainsi qu’un rabousille qui est une pièce de toile, de mousseline, d’indienne, d’étoffe de drap d’or ou d’argent, selon leur faculté. Cette rabousille leur dessert jusqu’à la gorge qu’elles montrent presque toujours. Elles en sont plus pardonnables, vu qu’elles l’ont très blanche. Elles la serrent autour du visage d’une si grande force qu’il faudrait qu’elles fussent bien maigres pour ne pas paraitre bouffies. Leurs souliers sont déchiquetés de dessus et elles les portent si courts qu’elles sont obligées de tenir leurs doigts crochus. Elles ne portent jamais de bas blanc et encore moins de soie qui sont chez les minorquines une marque d’inconstance pour les filles, et d’infidélité pour les femmes. Elles portent leurs cheveux en ce qu’elles font avec des rubans d’argent ou de soie qui leur va jusqu’aux talons. Elles ont leurs cheveux si longs attendu que la poudre ni les fers ne leur gâtent point, vu qu’elles ne se servent ni de l’un ni de l’autre. Tous leurs doigts à l’exception du pouce sont chargés de bagues où l’or qui y est en profusion ne le cède en rien à la grosseur des pierres, qui sont presque toujours de verre. Elles portent autour du col un chapelet qui leur tombe jusques à leurs jupons, à grains d’or, au bout duquel est un reliquaire assez grand. Elles en portent un de semblable à leurs mains qu’elles ne quittent de toute la journée que pour boire ou manger. L’habit noir est celui qu’elles portent à l’ordinaire aux processions ou à leurs visites. Tous les jours de fêtes et dimanches, elles étalent leurs cheveux au milieu de la rue ou sur le devant de la porte et se peignent entre minorquines, montrant des cheveux fort gras et toujours couvert de poux. Pour si peu qu’un homme soit familier avec elles, Français ou non, elles leur proposent de leur tirer les poux, et c’est une grande impolitesse que de leur refuser, quoique vous en ayez point.

Jamais d’autres que les véritables mères n’allaitent leurs enfants, on les voit partout jusque dans les églises un enfant pendant à la mamelle, un autre qu’elles tiennent par la main, et le plus souvent un troisième. Il ne faut point par conséquent être surpris dans une île de si peu d’étendue, l’on y voit tant de monde. On distingue une femme de condition d’une qui ne l’est pas aux mains : celles-là seulement portent des gants ou des mitaines, mais d’ailleurs elles ne sont pas plus propres que celles-ci. Lorsqu’il y a quelque femme de mauvaise vie dans l’île, on l’envoie a Mayorque au refuge, n’y en ayant point dans l’île.
Les femmes et filles dans ce pays sont pires que des sauvagesses. Lorsqu’un Français veut leur souhaiter le bonjour, dans les rues, très polies elles leur dépondent des impolitesses comme cabo d’ase (tète d’âne), tros de porc (morceau de cochon), demoni (démon) et ainsi du reste les enfants de cinq ou six ans vous répondent la même chose. Il y a une raison pour que ces femmes vous répondent ainsi, c’est pour vous dégouter de leur dire la même chose, attendu qu’elles veulent passer pour des vestales, regardant toujours la terre, ayant leur chapelet aux mains et l’autre au col. Elles prennent toutes du tabac pour si jeunes qu’elles soient, elles ont leur tabatière et ne font point de difficulté d’en demander, étant dans les maisons aux Français, venant même de leur dire des sottises, mais ceux-ci sachant à quoi s’en tenir, ne leur refusent point et se font une gloire au contraire de vider leur tabatière dans la leur, disant qu’ils veulent toujours rendre le bien pour le mal.
Les filles se marient en dépit de leurs parents après quelques formalités prescrites par les lois du pays, que les prêtres ont soin de leur expliquer de temps en temps. Le plus souvent elles se font enlever par leur futur époux et vont se réfugier chez une de leurs parentes où elles restent jusqu’à leur mariage, c’est-à-dire où elles couchent et mangent car elles ne sont point privées des offices et de faire des visites. C’est ordinairement à l’âge de douze ou quinze ans qu’elles se marient et la bénédiction nuptiale ne se donne point à l’église mais dans la maison où se trouve la fiancée. Le curé accompagné de tout son clergé et de grand nombre de moines leur donne cette bénédiction dans leur chambre quelques minutes avant la consommation du mariage. Cette bénédiction étant donnée, les nouveaux mariés baisent la main du curé et à toute la suite, et leur donnent ainsi leur congé. Cette cérémonie se fait ordinairement à minuit. Le lendemain, les nouveaux mariés donnent à dîner à leurs parents et à tous ceux qui ont assisté à la cérémonie, prêtres ou autres, et on leur sert ordinairement un cochon par tête, une gigue, un dindon, une poule, un lapin, un melon, selon la saison et autres petites choses le tout à un chacun. La viande est toujours cuite au four.
Les hommes sont grossiers, avares, jaloux, méfiants, laids, portant toujours un gros manteau, ayant continuellement la pipe à la bouche, même les petits enfants de trois ans. Ils se croient autant que le gouverneur. Si vous leur rendez quelque service, ils ne vous en font point d’obligation et croient que vous y êtes obligés. Ils sont très sobres, il est fort rare d’en voir un de saoul. Ils ont la tête presque rasée.

SI un jeune homme souhaite se marier avec une fille, il ne lui parle même point, il se contente d’aller quelques fois dans la maison de son père souhaitant le bon jour à la fille en entrant, et commence la conversation avec le père ou la mère.
Touchant à la monnaie du pays, qui est la même qu’en France, avec la seule différence que l’écu ne vaut que cinquante-quatre sols, leur plus petite monnaie est des doublets, ce que nous appelons en France d’Ardennes, et complète aussi par des pièces de huit, quoiqu’il n’y en ait point, qu’ils font valoir quatre francs pièce. Où ils s’entretiennent, dis-je, sur leur commerce qui consiste en blé de barbarie, ou sur leurs courses car ils sont presque tous corsaires.
Quand un garçon veut témoigner beaucoup d’amitié à la personne qu’il aime, il fait provision d’oranges aigres ou douces et, se mettant à l’affut dans quelque coin de rue, lorsque les filles ont le malheur (selon moi) de se mettre sur leur porte, ils leur envoient de toutes leurs forces une grêle de ces oranges achetées qu’elles endurent jusques à ce qu’elles soient toutes gâtées, ou que la grande quantité des meurtrissures les fassent rentrer. Mais il faut qu’elles ressortent peu de temps après pour témoigner à leur cavalier leur reconnaissance. Le soir ceux-ci vont avec une guitare toute discordante, instrument du pays, vont, dis-je, à la porte ou sous les fenêtres de la demoiselle jouer quelques-uns de leurs airs ou chanter quelque chanson du pays, comme en pleurant et parlant beaucoup du nez. Ils lui demandent dans leurs chansons si elles se portent bien, si elles sont couchées, ou de leur ouvrir la porte si elles ne le sont point. Et si ces demoiselles ont quelques amitiés pour eux, couchées ou non, lui ouvriront la porte et après une conférence d’environ un quart d’heure, elles se retirent et les cavaliers continuent de jouer ou de chanter jusqu’à ce qu’ils les croient endormies. Vous voyez des filles qui peignent leurs amants chez elles et leur chercher les poux, animaux dont ils sont très chargés, leur appuyant la tête sur leur tablier, comme le font les femmes à leurs maris et les mères à leurs enfants.