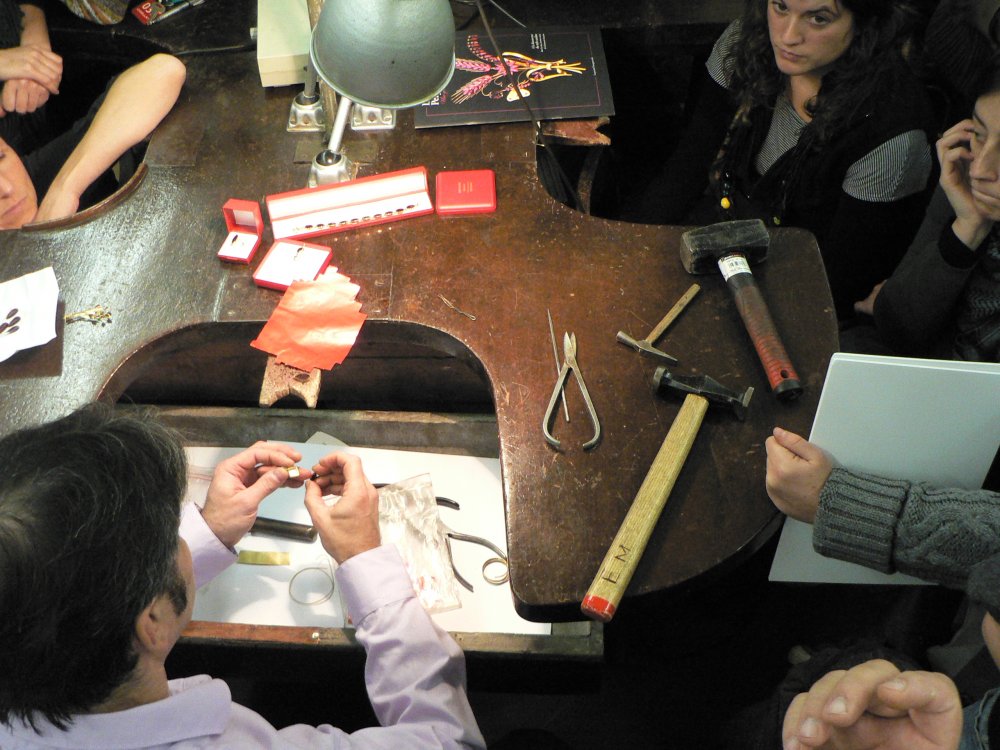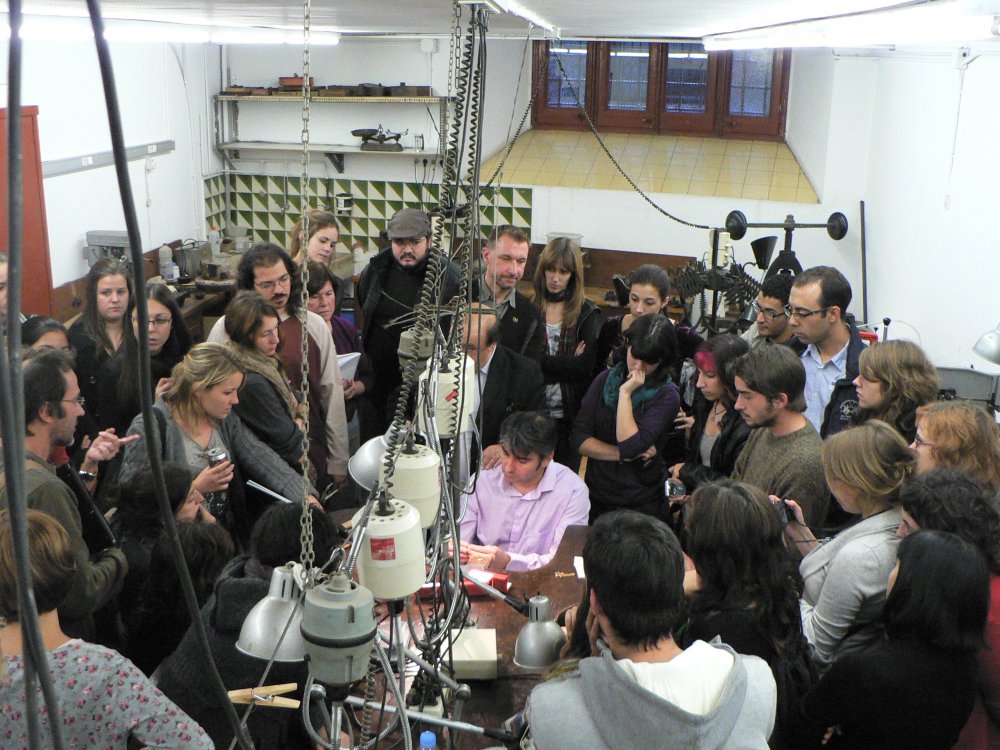Bathilde d’Orléans, mère du duc d’Enghien, miniature
Peu après arrivait la nouvelle que Louis XVIII était proclamé roi de France, que l’état de siège était levé, que le duc d’Angoulême se rendait à Narbonne sur l’invitation du maréchal Suchet ; ce fût un cri général de « Vive le Roi ! ». Dès le 25 avril 1814 M. Jaubert de Passa lança une circulaire aux Maires de l’arrondissement pour leur annoncer l’heureuse nouvelle. »
Dès lors, raconte M. Jaubert de Passa, on s’agita à Perpignan pour composer une députation chargée d’aller saluer le prince et l’assurer en particulier du dévouement d’un certain parti. M. du Hamel se hâta de convoquer les fonctionnaires publics et les entraîna à sa suite jusqu’à Narbonne. Par la rapidité de sa marche, il déjoua le parti qui voulait le dominer et qui se résigna à devenir son auxiliaire. A cette condition il y eut paix et bon accord apparent… Le prince se montra du reste fort gracieux envers tout le monde. Naturellement bienveillant et je crois aussi timide, on entrevoyait pourtant son désir d’expédier au plus vite les visiteurs, tout en voulant leur laisser une impression favorable. La conclusion constante de ses réponses fut toujours un vœu de conciliation.
La duchesse de Bourbon, qu’on aurait pu croire prête à faire retomber sur les serviteurs de l’Empire la mort de son fils, le duc d’Eoghien, fusillé à Vincennes sur l’ordre de Napoléon, se montra plus conciliante encore. Cette malheureuse vivait depuis 1797 en Espagne dans un état voisin de la misère. Lors de sa déportation elle avait traversé Perpignan et elle n’avait pas oublié sans doute les avanies dont son homme de confiance, le représentant du peuple Rouzet, avait été victime au Perthus ; mais elle était chrétienne et elle avait pardonné à ses ennemis. Elle arriva à Perpignan le 10 mai 1814.
Au jour indiqué par Madame de Bourbon, raconte M. Jaubert de Passa, l’Etat Major de la division alla attendre au Boulou Son Altesse Sérénissime ; le préfet entouré de fonctionnaires publics se tenait en avant de la porte Saint-Martin. Une foule immense encombrait les rues et les abords de la ville.
A l’approche du cortège, je remarquai derrière la voiture de la princesse et quelques pas en avant de l’Etat Major, un bourgeois affublé d’un habit bleu râpé et taillé à l’antique; il était coiffé d’un vieux tricorne mélangé de rubans blancs. Cet homme d’un sérieux imperturbable excitait la curiosité publique. Il était enfourché sur une maigre haridelle qui pouvait à peine le porter. On était à la recherche de son nom et personne ne le trouvait. Dans certains groupes on le supposait attaché au service personnel de la princesse, et on faisait en sorte de ne pas le trouver trop ridicule. Dans d’autres on riait sans gêne, et ce qu’on avait de mieux à faire, car le susdit personnage avait été remarqué de son côté par la princesse qui le supposait un notable de la ville. Très certainement ce personnage entendait jouer son rôle: mais à quel titre?… nul ne le savait; mais il était là, derrière la voiture, au poste des serviteurs, et on l’y laissait par la raison bien simple que chacun craignait de commettre une méprise en l’invitant à se retirer.
La réception officielle à la porte de la ville fut courte et révérencieuse, selon l’usage, et à peine les chevaux reprenaient leur marche que des zélés, groupés d’avance, cernèrent la voiture et entonnèrent bruyamment l’antique chant national d’Henri IV. Ces démonstrations criardes et par trop populaires alarmèrent la princesse, car les réceptions d’autrefois lui avaient laissé d’autres souvenirs.
Placé, selon mon droit, à la portière de gauche, j’eus bien de la peine à lui persuader que les chants qui l’assourdissaient étaient un témoignage d’allégresse. Pauvre femme ! A peine rentrée sur le sol tant regretté de la France, elle y retrouvait une alarme, et son œil inquiet disait assez son défaut de confiance dans son nouvel entourage. Du reste, c’était une bonne petite vieille complètement ridée, simplement mise et coiffée d’une capote poudreuse. Évidemment, il lui tardait d’arriver et de reposer ses yeux ailleurs que sur un rassemblement populaire.
La princesse fut reçue à la préfecture par Madame du Hamel (née de Chastenier de la Chastaigneraie) dame d’un excellent ton et recommandable sous tous les rapports. Avec elle la sécurité rentra tout à fait dans l’imagination fort agitée de la duchesse. La première figure que je remarquai dans le salon fut encore celle de l’écuyer inconnu, debout et immobile derrière le fauteuil de S.A. R. Cet homme s’était glissé jusque-là à la façon des taupes et paraissait y remplir un emploi quelconque ; personne ne fut assez osé pour le questionner. A son tour la duchesse témoigna le désir de savoir son nom, et il ne se trouva autour d’elle personne d’assez renseigné pour lui répondre. En attendant, l’audacieux inconnu resta au poste qu’il avait conquis. Or cet homme, d’un âge mûr, d’une allure surannée, à l’attitude froidement et résolument servile ne venait pas de Figuères. Le matin de ce même jour il était sorti de son taudis de Villeneuve-de-la-Raho, et s’était porté en avant du Boulou, pour prendre la tête du cortège et montrer sa figure. Il avait nom Jaubert, et était frère de trois autres Jaubert que Perpignan a connus depuis leur retour de l’émigration. Peut-être dirai-je quelque chose plus tard de tous ces Jaubert ; mais pour le moment je m’en tiens au plus original des quatre.
Durant son exil en Catalogne, le dit Jaubert, en cherchant un gîte et du pain, avait de plus rencontré une femme, pauvre comme lui, et attachée comme lui à Madame la duchesse d’Orléans, alors déjà installée à Figuères. Mademoiselle de la Chasse était de condition et son nom devint un passe-port à son mari. Lorsque la duchesse et la princesse Adélaïde se furent retirées à Majorque, et de là à Londres, l’apprenti courtisan se sépara momentanément de ses protectrices, pour venir soigner quelques intérêts agricoles en Roussillon. Il se trouva donc disponible le jour de l’arrivée de la duchesse de Bourbon, et s’en alla vers elle avec l’espoir de conquérir un appui, ou une position. Malheureusement il était aussi pauvre d’esprit que de bourse, et les princes, dit-on, n’aiment et ne donnent qu’à ceux qui n’ont besoin de rien.
Voilà bien des obstacles pour échouer ; mais disons aussi que pour rétablir un peu l’équilibre, Dieu avait doué le dit Jaubert d’une constance admirable pour poursuivre sans relâche le rêve de toute sa vie : une place quelconque à la cour. Il n’y a souvent qu’à vouloir pour réussir fût-on sot ou pauvre ; bien des gens ne savent que souhaiter. La volonté d’arriver vint donc au susdit, et plus tard, en subissant des épreuves , des dégoûts et des refus, il n’en devint par moins écuyer de M. de Bourbon. A l’âge de la princesse cette charge était une sinécure et tout profit pour l’ancien émigré. Avec les économies qu’il opéra sans peine, il acquit un domaine près de Thuir, et mourut riche.
ïl est temps de reprendre mon récit.
Le lendemain de son arrivée à Perpignan, la princesse monta en voiture, et, au milieu d’un immense cortège, descendit à la cathédrale pour remercier la Providence d’avoir mis un terme à son exil. L’inévitable Jaubert se montra à point nommé, s’empara du livre de prières de S. A. R. et marcha gravement derrière la voiture. Cette fois l’incognito était levé, on était en droit de faire une exécution, mais personne n’en eut le courage: cette figure amusait. Qui sait si l’original ne riait pas sous cape de notre gaieté, car lui avait un but qu’il poursuivait avec persévérance. Quoiqu’il en soit, il alla plein d’assurance s’installer dans le chœur, derrière le fauteuil de la princesse. Des procédés aussi obséquieux en présence des fonctionnaires publics et des notables, laissèrent, à ce qui paraît, de bons souvenirs à une princesse bonne, simple, obligeante, et qui, la veille encore, était inquiète de la réception qu’on devait lui faire à Perpignan.
Le surlendemain la princesse quitta Perpignan au bruit du canon et au milieu de la population accourue sur son passage. M. du Hamel et moi, nous étions à cheval, et nous prîmes place aux deux portières delà voiture qui traversa la ville au pas des chevaux. Derrière et en avant était une garde d’honneur organisée clandestinement par le parti des purs et en tête de laquelle apparaît le susdit Jaubert, enfourché sur sa rossinante. Le trajet jusqu’à Salses s’opéra avec calme, mais en prenant congé de S. H. l’écuyer futur, enchanté d’avoir eu, au baise-main, une part égale à la nôtre, se tourna vers la garde d’honneur, comme s’il en eût réellement été le chef, et dit en ôtant son chapeau : Allons, Messieurs ! Vive le Roi ! et vive Mme la Duchesse de Bourbon !… et la garde de répondre : Vive le Roi ! vive Mme la Duchesse de Bourbon ! à bas les Droits- Réunis !… Pour le coup la mystification devenait intolérable. La Princesse en parut fort embarrassée ; le préfet se fâcha, et le dit Jaubert-de-la-Chasse, insistant encore de sa voix éraillée, provoqua une seconde manifestation plus bruyante que la première. La princesse partit sans mot dire et nous tournâmes bride à la garde royaliste. Cette vengeance des royalistes de la haute société était platonique ; celle du peuple le fut moins. Pendant les premiers jours, distrait par le passage du duc d’Angoulême à Narbonne et le séjour de la duchesse de Bourbon, il fut accessible aux paroles de conciliation; mais quand il apprit que partout ailleurs dans le Midi l’on s’élevait contre les hommes et les institutions de l’Empire, le souvenir de tout ce qu’il avait souffert réveilla ses passions endormies. Les rapports de police nous apprennent que les troubles que nous allons raconter éclatèrent les 15 et 16 mai ; ils confirment le récit de M. Jaubert de Passa. L’émeute grondait déjà, dit-il, et des paroles sinistres attristaient la rue. Pour prévenir l’un des projets les mieux accueillis par la bande des pillards, j’allai avec M. du Hamel m’adosser contre la porte de l’Entrepôt de la Douane. Notez qu’en ce moment ces magasins placés pour la sauvegarde de l’autorité, renfermaient la valeur de trois millions de denrées coloniales. Après une heure de résistance, un détachement de 25 soldats vint renforcer le poste de la porte de l’Assaut, située en face de l’Entrepôt, et dès Celui-ci se trompe en les rattachant aux troubles qui éclatèrent le mois précédent, lors de l’abdication de Napoléon. A ce moment celui-ci fut à l’abri du pillage, Bientôt de nouveaux périls nous appelèrent ailleurs.
Après le feu de joie sur la Loge, l’émeute avait changé de chefs. Elle ne disait plus : à bas le tyran, mais bien : à bas les droits réunis et brûlons les Archives. Sur quelques points on criait aussi : allons aux perkales confisquées, ou bien : dévalisons le magasin des tabacs. Les pillards firent ce qu’ils disaient, mais ils échouèrent à l’Entrepôt dont la porte resta close, grâce aux soldats qui la défendaient. En suivant résolument la bande d’émeutiers qui paraissait la plus résolue, j’arrivai sur la Place d’Armes que je trouvai encombrée de bancs, de chaises, d’étagères et mouchetée par une quantité innombrable de papiers à demi consumés par le feu. C’est tout ce qui restait du bureau central des droits réunis. En quittant le feu de joie de la Place d’Armes, la bande alla s’abattre sur l’entrepôt des tabacs, rue Foy ou Na-Pincarda. La porte était neuve et forte ; on la brûla à demi, et les pillards profitant de la frayeur des locataires, envahirent la maison et se ruèrent sur le magasin. Quatre-vingt-quatorze caisses furent enlevées, et disparurent en quelques minutes au milieu de la foule des curieux qui encombraient la rue. D’autres caisses furent défoncées au profit des moins robustes et rapidement vidées. Désormais le pillage fut le mot d’ordre, et avec un succès de plus contre les dépôts publics, la foule enhardie serait devenue une force invincible.
Heureusement pour Perpignan, la Providence lui vint en aide, au moment où la partie de la population abusée par les premières démonstrations, puis intimidée par les émeutiers et par les menaces de pillage, oubliait lâchement que le moyen de défendre sa maison est d’aller défendre celle de son voisin. Quelques pillards venaient de se détacher du groupe principal, et, suivis par des femmes et des enfants, proposèrent de détruire les archives de la Sous-Préfecture. On ne détruit pas le mobilier d’un bureau sans livrer au pillage le reste du logis, et c’est bien cela que se proposaient ceux qui essayèrent d’enfoncer la porte de ma maison. En ce moment critique la rue était encombrée d’individus sottement curieux ou avides de désordre. L’un des meneurs proposa d’enlever les grilles qui ferment l’entrée du rez-de-chaussée. Des mains robustes s’accrochèrent aux barreaux et tentèrent de les ébranler à la lueur des flambeaux. Ma famille était vivement émue et s’attendait à des violences. Alors un bruit étrange venant du côté de la halle au blé, inspire à la tourbe se pressant derrière les démolisseurs une terreur panique et inqualifiable. Des cris d’effroi partent de divers côtés, la foule les répète dans les rues adjacentes ; tout s’ébranle, tout fuit, et avec la masse des curieux qui marchent en insensés à la suite de l’émeute, disparaissent les porteurs de flambeaux, les figures sinistres et tous les dévaliseurs de l’Entrepôt de tabac. En moins de cinq minutes le quartier fut désert.

Edward-Bird-1772-1819-arrivée-du-roi-louis-xviii-a-Calais (c) Wolverhampton Arts and Heritage
J’arrive sur les lieux, au moment où l’émeute disparaît devant un péril imaginaire, comme si la main de Dieu l’avait refoulée dans les bouges d’où elle était sortie. En rentrant chez moi, mon domestique, courageux et dévoué, m’explique cette retraite inespérée au moment où le péril paraissait sans remède. Deux charretiers armés de leur fouet qu’ils agitaient violemment à la rencontre des curieux, avaient mis ces derniers en déroute. De leur côté les pillards crurent entendre le bruit d’une voiture lancée au milieu de la foule, et probablement aussi un premier choc de la force armée. Ils prirent peur et s’enfuirent entraînant les autres, sans détourner la tête, pour apprécier le péril.
Deux hommes résolus suffirent donc pour mettre en déroute des rassemblements qui menaçaient la ville du pillage. Pourquoi se trouva-t-il deux hommes de cœur et d’exécution parmi cette foule de curieux, de lâches et vils incendiaires ?… c’est qu’un bon souvenir inspira aux voituriers la pensée de venir à mon aide. J’avais glissé, un jour, le faible secours de vingt francs dans la main de l’un des deux charretiers, pris au dépourvu et contraint de marcher sans retard avec un convoi. Avec ce don furtif le brave homme avait pu nourrir son attelage et celui de son frère : voilà mes deux sauveurs. Maintenant j’ai le regret d’ajouter que leurs noms me sont inconnus, malgré mes recherches. Ébahis du succès de leur démarche, ils avaient tout raconté à mon domestique, et puis avaient disparu pour ne plus se montrer. Cependant, dès son début, l’émeute s’était montrée trop hostile, pour que son prochain retour ne fût pas à craindre. La nuit même du désordre j’obtins du préfet la permission de réunir des gardes nationaux. Il y avait pourtant de graves motifs pour s’opposer à cette convocation ; la garde était divisée et prête à se dissoudre. J’espérai que les alarmes de cette nuit auraient tempéré l’aigreur des dissidents, et inspiré aux chefs de famille la bonne pensée d’une défense commune. Une démonstration à main-armée, dans une ville sans garnison, me paraissait urgente. La veille on l’eût probablement refusée, mais je la crus possible le lendemain d’un grave désordre ; je ne m’étais pas trompé. Le lendemain dès huit heures du matin, douze cents gardes nationaux avaient répondu à l’appel, et circulèrent dans la ville, l’arme au bras. Leur attitude ranima les pusillanimes, inspira de la confiance au parti de l’ordre, et modéra bien de folles prétentions. Je remarquai dans les rangs de la garde quelques imprudents qui avaient figuré la veille dans le premier rassemblement. L’émeute avait donné une grave et rude leçon à ces hommes honnêtes, mais beaucoup trop impressionnables. Ils se hâtèrent de manifester le repentir, et ce retour me rend indulgent envers eux. Voilà l’unique cause de ma discrétion, dans cette circonstance, où tant de noms honorables furent compromis et s’exposèrent à la rancune publique. Du reste, la démonstration publique que j’avais provoquée eut cet heureux résultat que, si elle fut impuissante contre certaines passions politiques, elle contint du moins les émeutiers et les pillards qui, le matin même de ce jour, avaient tenté encore de détruire les bureaux de l’Octroi. Elle leur prouva qu’ils auraient désormais contre eux une masse imposante d’hommes armés, décidés à défendre la ville et à réprimer le désordre. Le champ de bataille, c’est-à-dire la voie publique, resta donc libre aux nouveaux convertis au Royalisme.
Ils n’en abusèrent pas et notre pays ne connut pas les troubles qui ensanglantèrent le Midi de la France, tant à cause du « caractère fier et généreux de ses habitants », que par suite de la résistance imposée par l’autorité aux premières tentatives de désordre. Un arrêté ministériel récompensa MM. du Hamel et Jaubert de Passa de leur zèle, en leur conservant provisoirement les fonctions qu’ils tenaient de l’Empereur.

intérieur perpignanais
Source : Société agricole, scientifique & littéraire des Pyrénées-Orientales, J. Comet, 1896.