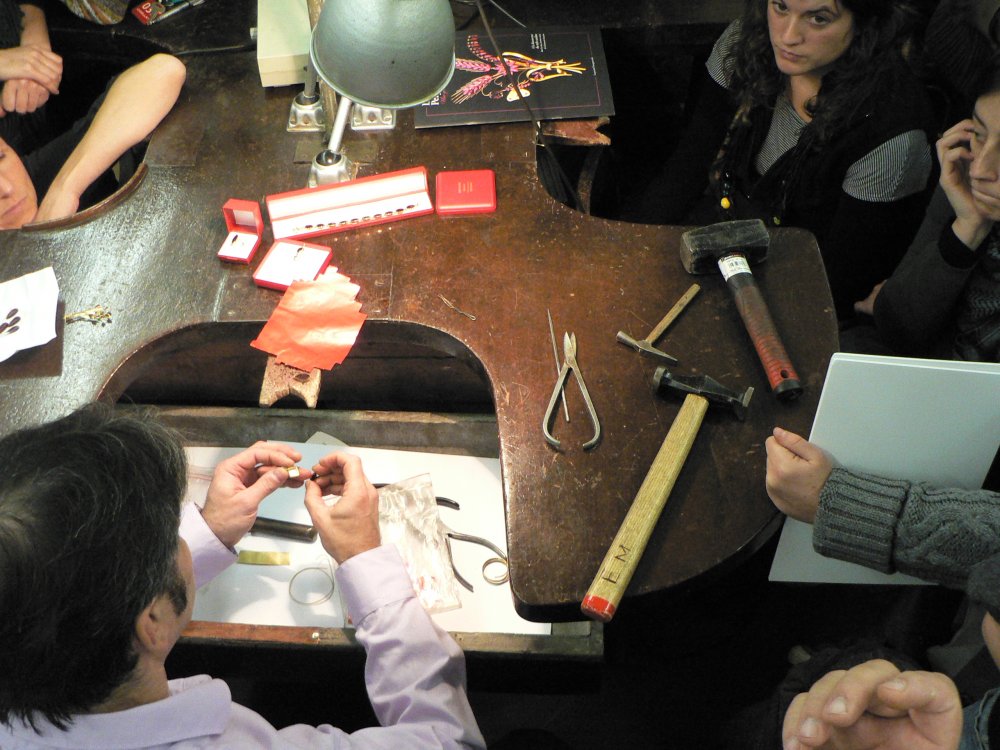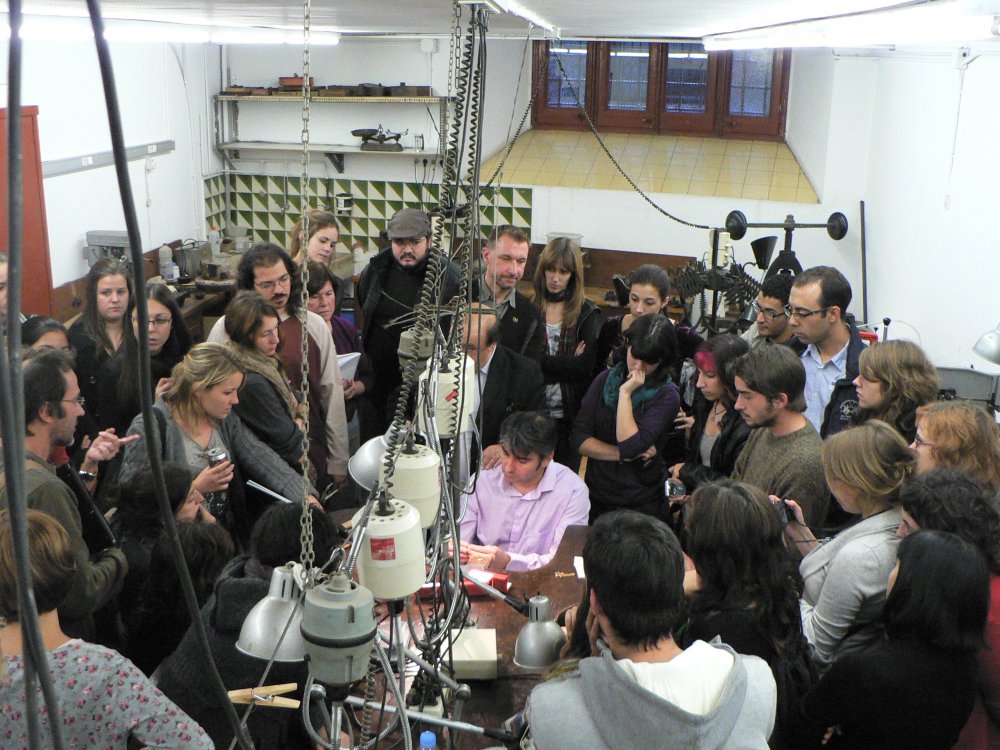Perpignan vers 1814
L’on arriva ainsi aux premiers jours d’avril 1814, sans trouble à l’intérieur, sans apparition de troupes espagnoles à la frontière. Chacun attendait la fin du drame qui se jouait à Fontainebleau et l’immense majorité de nos compatriotes, les uns par attachement à leur roi, les autres en haine de la tyrannie dont ils pâtissaient, tous avec le désir de la paix et de la liberté escomptaient l’arrivée du courrier qui apporterait la nouvelle de l’abdication. Le 21 avril on apprit la création du gouvernement provisoire et ce jour-là le Conseil municipal, présidé par le maire, M. Delhom-Ripoll, envoya une adresse au nouveau pouvoir.
Notre ville était alors en état de siège, sous les ordres du commandant de place, le général Paris. Tout à coup, raconte M. Jaubert de Passa, le bruit se répand à Perpignan que les Espagnols ont franchi la frontière, que l’Empereur est trahi par ses lieutenants, et que la France va être livrée à l’étranger. La garnison de Perpignan pousse alors des cris d’indignation. Elle court aux armes, méconnaît la voix de ses chefs, et force les portes de la ville. Les plus impatients sautent du haut des remparts, (à l’angle du bastion Saint-Dominique) et, réunis par bandes, en dehors de la ville, les soldats s’acheminèrent vers Narbonne, sans s’assurer de la réalité du péril. Il ne reste plus dans la place que les généraux et le corps des officiers. Dès lors une grave responsabilité pèse sur ces derniers ; ils le comprennent et le courage s’éteint dans des corps de bronze. Bientôt, de nouvelles rumeurs s’élèvent et agitent, cette fois, la population. Des bruits sinistres se propagent durant les retards qu’éprouvent les courriers venant de Paris, et derrière le fantôme d’un gouvernement provisoire on entrevoit pour la première fois la famille des Bourbons.
Que faire ?… il y a péril pour ceux qui tenteraient de prolonger la résistance ; péril peut-être pour ceux qui fléchiront de trop bonne heure ; péril pour tous quoiqu’on fasse. Les généraux sont sans initiative et rejettent sur les autorités civiles les mesures à prendre contre l’émeute qui gronde. Heureusement, le préfet du Hamel, trouve dans le passé de sa famille de nouveaux devoirs à remplir. Je reçois ses confidences à titre d’ami ; il sait que de mon côté je prends au sérieux les charges de mon emploi et que je suis peu disposé à servir un nouveau prince. Le matin, et de très bonne heure, je mande à la Préfecture le Maire de Perpignan. Celui-ci toujours disposé à esquiver des secousses populaires et l’obligation de les prévenir, se fait remplacer par son adjoint.
Ici commencent les lâchetés civiles, et désormais elles se multiplieront sans vergogne. Je force l’adjoint à des aveux, car je sais que les émeutiers lui ont fait des confidences. Je lui impose des mesures de résistance en présence du préfet, et il promet d’obéir. Quelques heures plus tard j’apprends que la Compagnie des pompiers, le seul appui qui restât à l’autorité, dans l’intérêt public, n’a pas été convoquée ; que l’Hôtel de Ville est ouvert et sans gardien ; que la salle d’honneur n’est pas close et que l’on se dispose à livrer le portrait de l’Empereur aux mains des émeutiers réunis dans un café voisin. Je cours chercher le maire au fond de la promenade des Platanes, et lui intime l’ordre d’aller défendre son poste à la Mairie. Le pauvre homme balbutie, cherche des excuses et m’oppose en tremblant je ne sais quels périls personnels. Tandis qu’il parle l’émeute survient au pas de course et nous enveloppe.
Parmi ceux qui vocifèrent j’entrevois des figures connues que je pourrais nommer, mais je ne veux pas les exposer à rougir tardivement ; d’ailleurs, depuis 1814, elles ont eu mainte occasion de regretter publiquement leur fol entraînement. Je vais droit à ces figures et ma voix les intimide ; aucune ne tente de résister ouvertement. Il n’en est pas de même avec le maire, les émeutiers qui l’entourent vont jusqu’à la menace, parce qu’on le sait faible et prêt à céder. Alors j’abandonne ce dernier et me dirige rapidement vers l’Hôtel de Ville. La foule devine mes projets et elle plante là le maire, pour me devancer. Je ne pouvais lutter avec elle avec mes jambes et la suivre à la course. Lorsque j’arrivai à la Loge je trouvai déjà le portrait de l’Empereur lacéré à coups de couteau, et jeté sur un bûcher dressé à la hâte.
François JAUBERT DE PASSA, mémoires.