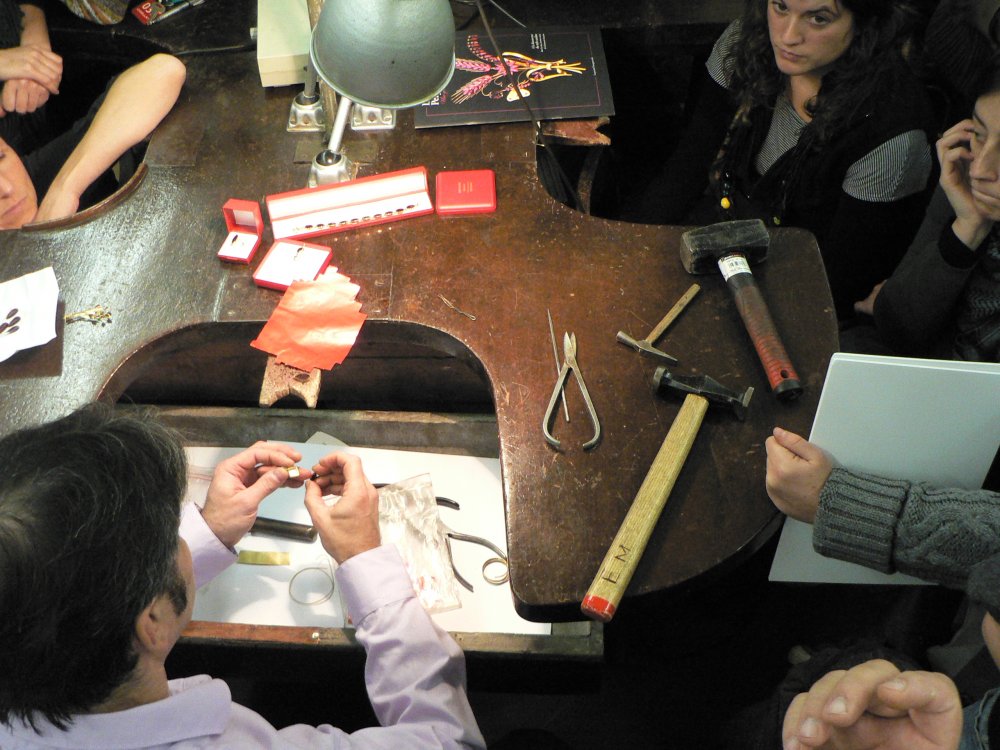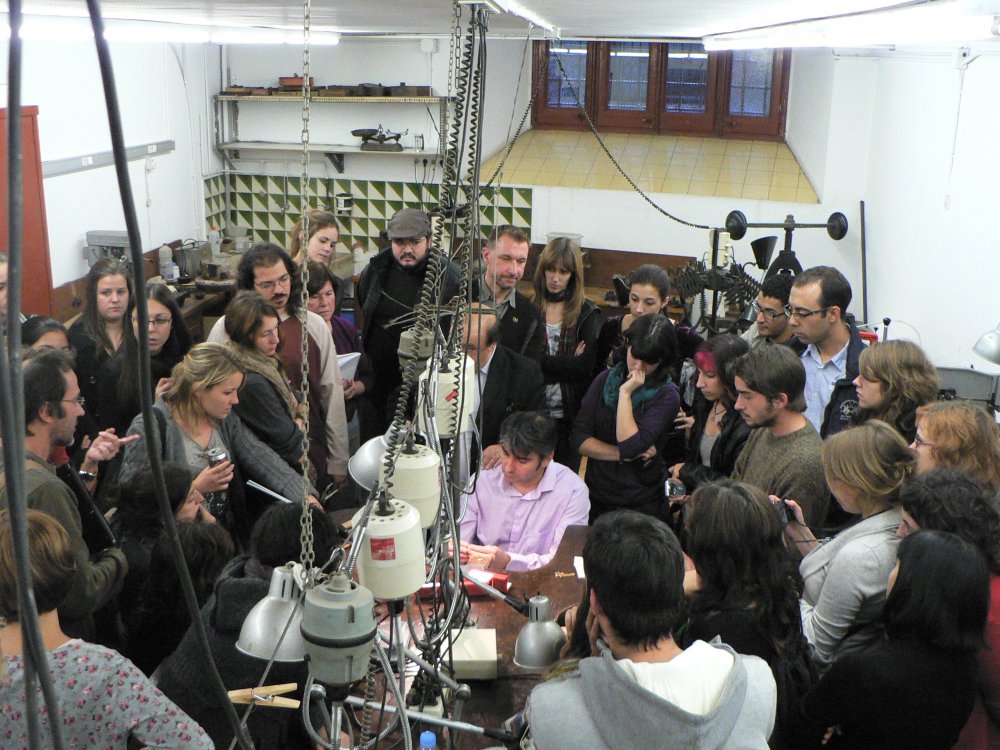La Catalane se dirige vers la fontaine qui, à une faible distance du bourg, jaillit des rochers dans un bassin moussu. En chacune de ses mains elle tient une cruche d’argile rouge aux flancs d’amphore dont le pourtour de l’anse, les goulots vernissés luisent ainsi que des miroirs et reflètent les tons du ciel.
La catalane est jeune, fraîche comme la tramontane, noble dans son allure, involontairement, naturellement. Sous son costume se devinent les lignes sculpturales de son corps. Sa marche légèrement cadencée rappelle la canéphore antique. Elle est belle dans la simplicité de son corsage évasé sur un cou fort et halé. Les pointes de ses seins semblent vouloir crever l’étoffe trop ajustée qui dessine les formes de son buste, en révèle les contours exacts et harmonieux.
Sous sa robe à rayures recouverte d’un tablier de percale noire semée de minuscules pâquerettes son ventre bombe imperceptiblement. Elle a les lèvres rouges, juteuses, tentantes à l’égal d’un fruit mur durant l’été, des pommettes un peu saillantes, la face un peu large signe caractéristique de la race, le nez délicat, les narines fines, mobiles, la teinte de ses prunelles est comparable à celle des grenaches banyulencs, des malvoisies que produisent les territoires de Cases de Pène et d’Estagel. Sur son front frisent les cheveux châtains en festons soigneusement ajustés et qui accompagnent si bien l’escofion de dentelle, le bonnet coquet prêt, dirait-on, à s’envoler au moindre souffle.
Ah ! Comme ses pieds chaussés d’espadrilles aux dessins multicolores et vifs, dont les tresses bleues s’entortillent autour des chevilles, martèlent vigoureusement le sol ! Elle rit, sans savoir pourquoi, peut-être, d’un rire roucoulant, qui a quelque chose du glouglou d’un ruisselet, d’un rire chantant , sensuel. Elle rit parce que la vie monte en elle, puissamment, parce que se dents sont nacrées et superbes. Elle rit au zéphyr rôdeur, à l’insecte bourdonnant contre sa joue nuancée de même qu’une pêche d’Ille ; en songeant aussi à l’amoureux qui l’attendra, après le crépuscule, au tournant de la route que bordent les oliviers au feuillage argenté par la lune.
Balancée sur ses jambes solides, elle dévale par le chemin rocailleux, où les schistes roulent sous ses semelles de corde de sa chaussure, et à l’extrémité duquel sourd, abritée par un platane, l’onde qui désaltère les villageois. Toujours des groupes de femmes s’attardent là à bavarder et tandis que la cruche déborde, faisant entendre un doux murmure, on y cause de l’un, de l’autre, on y médit, on y conte des histoires gaillardes. Les cigales susurrent dans les branchages contournée des proches amandiers, une haleine ardente s’exhale de la terre, et les blés immobiles sont d’or, au sommet de la colline, contre l’azur profond.
Qu’importe à la Catalane le soleil brûlant ! Elle s’entr’ouvre le haut du corsage, livre sa gorge à l’air. D’un geste brusque elle ramène ses jupes entre ses jambes, les y enserre, emplit d’eau le creux de sa main droite, la porte à sa bouche. Elle boit, la tète renversée en arrière, tendant sa poitrine, son cou qui se gonfle, et des gouttelettes irisées glissent le long de son menton, mouillent son visage, tremblent au bout de ses cils recourbés. Puis ranimés par cette affusion, elle reprend la sente menant au seuil familial. Une voisine penchée à la fenêtre la hèle, un garçon en la croisant lui lance une gaudriole, lui décoche une œillade polissonne. Elle rougit et son rire raisonne, ce rire voluptueux, perlé, glougloutant qui donne envie d’aimer.
Oh ! Catalane, fille de mon pays, que tu es attirante, lorsque tu passes, allègre et capricieuse, pareille aux chèvres de nos montagnes, allant ou revenant d’étancher ta soif à la source coulant du tertre herbeux sous la nappe immense d’outre-mer qu’est le firmament de notre petite patrie.
Fille de mon pays, demeure ce que tu es, quoi qu’on te conseille. Méprise les falbalas et les colifichets des villes, les hideux chapeaux citadins. Garde le charme de tes atours rustiques. Sois demain ainsi qu’hier, l’incarnation des campagnes natales. Tu en symbolise l’âme, vision délicieuse qui ne s’efface plus de la mémoire et dont le souvenir met au cœur-un regret.

Source : Perpignan Illustré, 1911